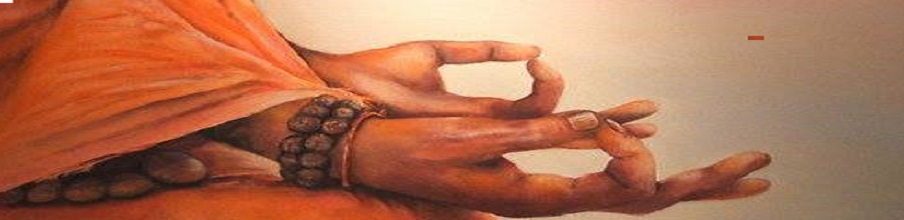ASHTANGA
Les bases du Yoga selon Patanjali
YS, II. 29
(YS : Yoga Sutra de Patanjali, texte de Patanjali appelé Pradipika, « la petite lampe »
Recueil d’enseignements oraux de yoga)
Texte tiré de « La sagesse du désir » de C. Berthelet, et ajouts de Madhuri
■ É T H I Q U E
I – YAMA (contrôle)
Attitude souhaitée vis-à-vis d’autrui, on « restreint » les poussées égotiques.
Maîtrise de soi pour vivre ensemble. Au-delà de nos pulsions, la prise en compte de l’autre.
Et s’il y a bien quelqu’un qui nous met en enfer ou au paradis, c’est l’autre.
– ahimsâ, la non-violence, non nuisance, la bienveillance, la douceur et le respect. Selon Gandhi, pour être non-violent il faut être fort. Refuser de céder à la rage, à la brutalité présente en chacun d’entre nous. Douceur qui peut aussi être un outil de résistance, sans vouloir vaincre.
– satya, la vérité, l’authenticité, la véracité, « ce qui est ». Nous le demandons par exemple en chantant le mantra “asato ma sat gamaya” mais être vrai n’est pas toujours facile à vivre. L’articulation avec ahimsa est aussi un fil du rasoir dans les rapports humains. Dans le rapport à soi, l’humilité du Sat nous guérit du sentiment masochiste d’imposture…
– asteya, le désintéressement, l’honnêteté, le non-vol : ne pas garder pour soi ce qu’on pourrait donner, notamment dans la transmission. Non appropriation généreuse
– aparigraha, la non-possessivité, la non-avidité. En hindi, le verbe avoir n’existe que pour ce que l’on ne peut pas partager, par exemple les cheveux, etc. Pour un objet dont on est propriétaire, une voiture par exemple, la traduction littérale de l’hindi serait « la voiture à côté de moi », sans verbe avoir donc. Soulage de l’accaparement des choses mais aussi des idées et des êtres…Invitation à aimer sans attachement ni fusion. Attention : le détachement n’est pas l’indifférence!
– brahmacharia, la modération des désirs égoïstes. Souvent traduit par la chasteté. C’est aussi le premier âge de la vie (cf. les quatre âges de la vie dans l’hindouisme). En fait, il s’agit de ne pas consommer l’autre comme objet de désir. Ne pas suivre sa pulsion comme elle arrive. Différer sa satisfaction. Contenir nos pulsions et non « je fais ce que je sens ». discriminer. La pulsion, on peut la sentir sans se mentir, mais choisir de ne pas l’acter.
II – NIYAMA
La maîtrise intérieure: c’est le début d’une sadhana orientée vers la voie du yoga alors que les yama sont un code de vie éthique pour tous.
Travail sur soi:
– shaucha, la purification, la pureté, la propreté. physique, psychique et spirituelle: se nettoyer est un rite et une offrande. Le risque est l’excès, l’idéal de soi, le sentiment d’impureté parfois maladif. Ce serait plutôt comme dans la prière médiévale: « O Michel ange chevalier/ lave nos cœurs de nos rotures », lave-nous de nos côtés ig-nobles. Noblesse d’âme purifiée.
– samtosha, le contentement, consentir à ce qui est. Dire merci pour les épreuves. On ne les subit pas mais on leur donne un sens. Attention aux dénis, à l’angélisme et au masochisme. C’est très yin en apparence, cela demande une force puissante, source de joie Gratitude.
– tapas, l’effort, l’ascèse, l’ardeur. C’est l’élan renouvelé, le feu qui refuse l’inertie, nous réveille brûlant d’amour. A mettre en relation paradoxe et équilibre dansé avec samtosha qui n’est pas la résignation. Attention aux excès, aux recherches de pouvoirs qui s’associent à une forme de toute puissance, au fanatisme accusateur.
– Svâdhyâya, l’écoute, l’étude de soi et des textes sacrés. Pourfendre l’ignorance (que l’on aime bien produire rappelle le bouddhisme), Travail d’intelligence et discernement, se connaître. Étudier ce que les maîtres ont vécu et transmis; en Inde réciter les textes de mémoire. la pratique des mantras joint ce niyama avec le suivant et bien sur le pranayama dans le souffle continu du japa (répétition).
– Îshvara-pranidhâna, pouvoir s’abandonner au Divin. […] « Prends toute la place » […] « ish » : origine; « sva » : soi; « ishvara » : forme par laquelle se révèle à nous ce qui est plus grand que nous. la forme et le nom qui nous touche et révèle Ce qui est au-delà de tout nom et toute forme (saguna/nirguna) S’incliner devant plus grand que soi. S’orienter, y consacrer sa vie.
(« Pranidhâna » : Grande prosternation. Îshvarapranidhâna, c’est s’incliner respectueusement devant le miracle de la vie ; c’est se laisser glisser dans les bras d’Îshvara ; frémir quand la Présence éveille en nous un élan qui invite à dédier chaque instant.
■ P R A T I Q U E ( H A T H A – Y O G A )
Vouloir, poursuivre et choisir. S’engager corps souffle et âme.
III – ÂSÂNA
Le travail postural.
Généralement, c’est ce que le grand public connaît du yoga. Toutes les postures conduisent à pouvoir rester assis en méditation. A la fois sthira “étiré”, redressé et shukha, en douceur: fermeté et souplesse, ouverture d’un espace intérieur. Trouver l’aisance dans la fermeté. Pratiquer intensément dans un esprit de lâcher-prise (paradoxe) ans chercher une performance.
Les effets d’une âsana arrivent au moment où l’on arrête la posture et on laisse venir l’écoute.
IV – PRÂNÂYÂMA
Le travail du souffle.
« Prana » : ce que l’on reçoit. ce qui nous régénère. par la respiration, l’alimentation, mais aussi par tout ce qu’on regarde, écoute: d’où la nécessité de choisir notre orientation.
– « Apana » est un aspect du « prana » : ne pas garder ce qui ne nous construit pas, que ce soit au plan du corps (excréter, expirer) qu’au plan du psychisme. ruminer le passé par exemple nous intoxique. Apana fait de la place pour recevoir le renouveau, l’inspiration.
– La respiration est la seule de nos fonctions qui soit semi consciente. C’est pourquoi nous pouvons la détraquer en restant en apnée, refusant d’expirer. La clé est dans le lâcher prise, expirer comme on accepte de mourir pour renaître. Enseignement de Shiva comme du Christ. Accepter la perte est un cheminement. Le Souffle nous traverse mais ne nous appartient pas.
– Les exercices de pranayama, respiration consciente et rythmée, suivent souvent cette logique :
– Expir vers une vibration que l’on visualise ou ressent, un appel.
– Pose à vide en contemplation, disponibilité.
– Inspir recevoir cette vibration vivante en soi.
– Pose dans la plénitude.
– Expir diffuser cette vibration vers un espace défini que l’on « colore » afin de le transformer.
- Il y a bien des variantes, des visualisations, des points relais pour conduire (yama) l’Energie (prana). Les tibétains ont beaucoup développé cette pratique.
■ EFFETS de la pratique
V – PRATYÂHÂRA
Intériorisation du corps, de l’âme, de l’esprit. Le retrait des sens, le recul. L’écoute intérieure nous libère de la tyrannie des sens .Un autre espace se déploie. Souvent utilisé comme approche de la méditation. Par exemple : Ecouter le silence entre les bruits. Devenir espace, vacuité.
VI – DHÂRÂNA
La concentration, recueillement. Focaliser l’attention dans une orientation choisie et tenue. Ce mouvement actif peut se répéter dans un aller-retour bienveillant, sans se culpabiliser, jusqu’à se fondre vers le centre. Image, mantras: supports pour ramener sur une seule vibration. (Ekam)
VII – DHYÂNA
La méditation contemplative, mouvement en expansion, rayonnement.
- Chan en chinois. Source du Zen.
- Déploiement, sentiment de vastitude, on n’est plus limité à qui on est, ni où l’on est. Rien à « faire », rien à attendre.
VIII – SAMÂDHI
« Vitarka-Vichâra-ânanda-Asmitâ-Rüpa», YS, I. 17
« L’état de yoga issu de la réflexion permet la réalisation de la Joie de ce qui est compris. »
C’est une grâce qui est au-delà de tout mérite. Un moment de « toucher de l’être » selon K. Durkheim. L’éveil dont la venue ne dépend pas de nous. Révélation : un voile se lève.
« Samadhi » : Joie ; il ne peut pas y avoir un maître qui “fait la gueule” tout en voulant transmettre le yoga.
Et…« Sat-chit-ananda » : nous ramène vers les Yama comme une évidence et non plus un effort. Ainsi, cela fait une boucle, une roue. La spirale de notre vie. Une fois au sommet de la montagne, on ne peut pas respirer, il faut redescendre. Incarner dans la dualité Ce qui a été révélé=> « Yoga-chitta-vritti-nirodah », YS, I. 2.
« Vritti » : ce qui nous fait tourner en rond. Ce qui empêche la conscience de se déployer. Retrouver le déploiement de notre vraie nature, alors que nous sommes marqués par nos imprégnations, nos refoulements. «Nirodah » : usure, effacement, cessation de ce qui déforme « Chitta« . La Conscience.
Tout yoga est « de l’énergie » et l’énergie se crée quand il y a une polarité.
NB : La Voie du Cœur = purna yoga. Yoga intégral
Fait de sagesses orientales et philosophies occidentales vécues, incluant tous les plans de l’être.
Nos fondateurs:
- Gabriel Monod Herzen. : le père de Gabriel était psychanalyste après avoir été patient de Freud. Gabriel était proche de Jung, Il a enseigné toute sa vie. Universitaire, alchimiste, engagé au service de son pays, disciple et maître, au service du cœur de la voie (Hertz: cœur en allemand). Intellectuel pratiquant le hatha yoga, karma yoga dans ses engagements, progressant dans le jñana yoga (on lui doit une traduction de la Bhagavad gîta) Il a développé le bhakti yoga avec un grand élan de coeur.
- Swami Hridayananda, (hridaya, en sanscrit: le coeur; ananda: la félicité) Mataji inspirée d’abord par Gandhi, puis disciple, amie et médecin de Sivananda Saraswati, grand maître à Rishikesh. Guru de Madhuri à qui elle a demandé de transmettre. A beaucoup enseigné le raja yoga.
- Ajit et Selvi Sarkar disciples de Sri Aurobindo, lui-même inspiré de Bergson, Pierre Teilhard de Chardin, grands formateurs de hatha yoga et danse.
- Karfried Graf Durkheim et tant d’autres…